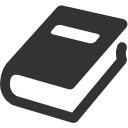25e édition du Prix de l’Entrepreneur de l’Année
Un état des lieux :
Si la France est le champion occidental pour le nombre de créations d’entreprise entre 2007 et 2011 (du fait des autoentrepreneurs), le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté (base 100 en 2007 contre près de 140 depuis 2014 alors que ce même indice est inférieur à 90 aux Etats-Unis). C’est que parmi ces entreprises, beaucoup sont fragiles et génèrent peu de chiffre d’affaires.
Le phénomène des start-up, né dès les années 90, déterminant pour le développement économique et la compétitivité de la France, reste un phénomène marginal (10 000 à 30 000 start-up selon les sources) sur plus de 3 millions d’entreprises… Ces start-up sont fondées par des personnes qui ne représentent pas l’entrepreneur moyen : 90% d’entre eux sont des hommes ayant un niveau de formation supérieure (souvent de niveau Bac+5).
Parmi ces start-up, plus rares encore sont celles qui parviennent à croître fortement et à lever des fonds : en 2014 et 2015 on compte à peine 50 entreprises de moins de 8 ans qui ont levé plus de 15M$ contre près de 1 500 aux Etats-Unis sur la même période.
Pourtant 90% des emplois créés par les start-up sont en CDI. Le cas de Paris est emblématique : les soutiens cumulés de l’Etat, de la région Île-de-France et de la ville de Paris contribuent à en faire une des places les plus prisées au niveau mondial (en 2016, l’index European Digital City classait Paris 3e ville la plus attractive parmi 35 villes européennes et 11e mondiale avec plus de 22 000 start-up employant près de 138 000 personnes). Paris est aussi classée 1re sur la croissance des activités d’innovations (cf. l’implantation de Google, Samsung, Facebook, Microsoft…), 2e pour le nombre d’espaces de coworking et 2e pour l’accès au capital en Europe.
La proportion d’entrepreneurs ayant un doctorat est 10 fois moindre que dans les autres pays développés en 2013. Autre élément différenciant, le pourcentage d’entrepreneurs étrangers en France est nettement inférieur à de nombreux pays : 11% à Paris contre 19% en moyenne dans les 40 villes comparables au niveau mondial.
Enfin, la proportion de jeunes femmes parmi les entrepreneurs est l’une des plus faibles d’Europe (22 % en 2013 comparé à 32 % pour les USA, près de 30% en Grande-Bretagne ou encore 44% pour l’Espagne).
“Contrairement à la fin des années 90, la France n’a pas besoin de plus d’entrepreneurs. L’urgence est surtout qu’ils nourrissent de plus grandes ambitions et acquièrent les compétences nécessaires à la création d’entreprise à forte croissance génératrice d’emplois. Pour cela, il faudrait par exemple plus de chercheurs parmi les entrepreneurs et plus généralement de talents, y compris étrangers…
Les entrepreneurs ne doivent plus être uniquement de bons chefs d’entreprise, ils doivent aussi appréhender les grands enjeux sociétaux, construire des visions d’avenir et proposer de nouveaux modèles pérennes. Pour les y aider, il faut certes penser ces questions au niveau national, mais aussi et surtout au niveau européen… A ce jour, les jeunes entreprises de croissance véritablement européennes sont encore trop rares au regard de l’émergence de géants chinois, américains ou encore indiens”
La formation
En 2016 en France, 34% des étudiants veulent devenir entrepreneurs (un des scores les plus élevés des pays de l’OCDE), contre 15% il y a 25 ans. Pour répondre à cette appétence, les formations diplômantes connaissent une croissance spectaculaire. Rien qu’entre 2014 et 2015, le nombre d’élèves suivant des formations en entrepreneuriat en France a augmenté de 20%, passant de 100 000 à 120 000 étudiants (5% des étudiants toutes disciplines confondues). Au sein des 10 meilleures grandes écoles de commerce et d’ingénieur françaises, 100% des élèves suivent au moins un cours en entrepreneuriat. Quant aux 10 meilleures universités en sciences et en économie-gestion, ces formations touchent désormais près de 65% des élèves. On compte désormais plus de 2005 enseignants-chercheurs dans le domaine, contre moins d’une cinquantaine il y a 25 ans.
Dans les 3 meilleures écoles de commerce parisiennes, les diplômés qui deviennent entrepreneurs sont 10 fois plus nombreux qu’en 2000.
Un élève ayant suivi une formation à l’entrepreneuriat a en effet 4 fois plus de chance de créer une entreprise qu’un individu n’en ayant pas suivi. Cet effet est nettement plus élevé en France qu’en Angleterre (2,4), Allemagne (2,8), Italie (2,3) ou Espagne (1,1). Le seul point noir reste l’extrême concentration des établissements qui forment les fondateurs des start-up à forte croissance; à titre illustratif, les entrepreneurs éligibles au Prix de l’Entrepreneur de l’Année en 2016 sont à 85% issus d’une Grande Ecole (principalement HEC, ESCP Europe, Essec, EM Lyon, Ecole polytechnique, Ecole Centrale, Télécom, Ecole des Mines, Science Po, Université Paris- Dauphine).
3 ruptures marquent la transformation des formations en entrepreneuriat :
-La demande pour des méthodes pédagogiques basées sur l’impact : comment changer le monde. Les programmes exigent des élèves qu’ils mènent des projets qui produisent de réels impacts durant leur formation. Il s’agit de vivre l’expérience de l’entrepreneuriat et non pas seulement de la comprendre.
-La multidisciplinarité est devenue la norme dans les formations : si l’on observe les 20 meilleures formations à l’entrepreneuriat en France, au-delà des modules centrés sur les expertises business, 60% proposent un cours de design thinking, 40% un cours de code et développement informatique et 25% un cours d’art et d’humanités.
-Le développement d’une dizaine de formations sans école et sans diplôme (Koudetat, Livementor, Engage University, The Cantillon, Learn Assembly, Le Wagon, Inco…) via des contenus en ligne, des conférences en soirée ou le week-end, des ateliers pratiques…
Cependant, les formations à l’entrepreneuriat sont confrontées à un défi bien plus grand que de simplement faciliter la création d’entreprises : l’enjeu de ces programmes est désormais de former les étudiants à de nouvelles façons de penser et d’agir; des modèles tayloriens utilisés durant le siècle passé, il faut désormais former aux méthodes entrepreneuriales comme l’effectuation et les méthodes agiles, car ces méthodes permettent de répondre à deux défis majeurs : l’incertitude et la limitation croissante des ressources. Il faut pouvoir expérimenter pour tester et pivoter en fonction des nouvelles contraintes qui émergent au fur et à mesure de l’avancée d’un projet.
A ce titre, les formations à l’entrepreneuriat ne doivent pas seulement servir à former des créateurs d’entreprises, mais aussi des professionnels des secteurs privé et public, afin qu’ils appliquent ces nouvelles formes de pensées à des modèles d’organisation plus traditionnels, et développent ainsi un leadership entrepreneurial.
L’accompagnement
En 2016, le taux de pérennité des entreprises hébergées par des incubateurs académiques a atteint 72% à 5 ans, mais avec peu d’emplois crées (4 en moyenne). Pour briser ce plafond de verre, sont lancés les accélérateurs dans les années 2000. En 2016, la France disposait de 2 285 incubateurs et de 49 accélérateurs; mais il faut ajouter la multiplication des tiers lieux (plus de 200 en 2016).
Aux Etats-Unis, trois accélérateurs (Y Combinator, Techstars et 500 start-up) sont associés à près de 10% des levées de fonds en série A l’an dernier contre 5 % en 2012. L’ouverture de Station F cette année et la maturité de certains accélérateurs (Numa, 50 Partners, Euratechnologies, DayOne Entrepreneurs & Partners, The Family…) pourraient produire le même phénomène en France où seules une dizaine d’organisations sont au cœur de l’accompagnement des principaux succès français… Cette concentration est renforcée par des effets de réseaux et le rôle déterminant de certains entrepreneurs à succès qui s’engagent pour aider les nouvelles générations (Xavier Niel, Frédéric Mazzella, Marc Simonci, Pierre Kosciusko-Morizet…).
Les structures d’accompagnement font face à un double défi : maîtriser des expertises plus nombreuses et complexes d’une part, appréhender les enjeux sociaux du processus entrepreneurial d’autre part.
En 25 ans, les concepts, théories et techniques pour augmenter les chances de succès d’une start-up ont proliféré : effectuation, lean start-up, design thinking, méthodes agiles de développement, business model… Il faut non seulement comprendre ces méthodes, mais aussi réussir à les mettre en place intelligemment en contexte, ce qui reste souvent un véritable défi.
L’enjeu est de plus en plus d’accompagner des projets à l’ambition mondiale dont les enjeux financiers, techniques et juridiques sont toujours plus complexes, plutôt que de développer des entreprises viables au niveau local.
Autre difficulté, le mot d’ordre « tous entrepreneurs »
Un besoin de professionnalisation du secteur de l’accompagnement s’impose, afin de délimiter leurs métiers, responsabilités et intérêts, autant que ceux des entrepreneurs qu’ils accompagnent.
Le financement de ces entreprises
La France a enregistré une croissance soutenue des investissements en capital-risque entre 2016 et 2017, soit +22%, au moment où les zones traditionnellement les plus actives, l’Amérique du Nord et l’Asie, connaissaient un ralentissement sur la période. Cette croissance a permis de hisser la France à la deuxième place en Europe : avec plus de 2,3Md€ en 2016 (contre 45M€ en 1998), cumulant 20% des montants levés, juste derrière le Royaume-Uni (36%), à égalité avec l’Allemagne. Bpifrance reste l’investisseur le plus actif au niveau européen, et la France, le pays qui compte le plus d’opérations au cours du premier trimestre 2017, notamment grâce à sa capitale, en passe de devenir la ville la plus active d’Europe; en 2015, c’est la région Île-de-France qui concentre la plus grande partie de ces investissements (68%).
Cette croissance s’est accompagnée de l’arrivée de nouveaux types d’investisseurs : les particuliers, via le financement participatif, les grands groupes, via les Corporate Venture Capitalists (CVC).
Le financement participatif connaît une croissance sans précédent et fait de la France le 2éme pays le plus actif derrière l’Angleterre (en 2016, 233M€ de fonds collectés, +40% par rapport à 2015); plus d’un million de Français ont financé 21 000 projets via du crowdfunding avec contrepartie (68,6M€), du crowd-equity (68,6M) ou encore du crowdlending (96,6M€).
Les Corporate Venture Capitalists, presque inexistants il y a 5 ans, ont connu une croissance exponentielle du fait des adaptations de l’environnement réglementaire (590 prises de participation pour un montant cumulé de 2,7Md€ en 2016, soit plus du double que l’année précédente); Ils investissent dans les start-up de croissance qui présentent généralement des synergies avec leur activité traditionnelle; le ticket minimum est en moyenne de 5M€.
Le capital-risque, longtemps dominé par les banques, a été progressivement soutenu par la création de dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement privé (le FCPI en 1997, le FIP en 2003, tous deux collectés par le réseau bancaire). Les changements réglementaires Bale III et Solvabilité II les ont contraints de s’adapter à ces normes nouvelles, avec une tendance à se retirer progressivement; dans les années 1990, les banques contribuaient à plus de 50% au financement du capital investissement contre moins de 10% aujourd’hui. Suite au retrait des investisseurs institutionnels, Bpifrance a comblé ce déficit de financement; en 2012, 95% des entreprises investies par le capital-risque et 99 % par le capital amorçage ont été financés directement ou indirectement par Bpifrance.
Le faible rendement relatif du capital-innovation lors des trente dernières années (1,4%) a eu tendance à freiner la venue d’investisseurs privés; l’inadaptation du capital humain est un des principaux facteurs qui contribuent à ce résultat; les profils des investisseurs français, montre une plus faible diversité de parcours en matière d’éducation et d’expérience avec notamment moins de profils scientifiques, d’anciens entrepreneurs et de diplômés de MBA que les Etats-Unis (aux Etats-Unis, 60% des investisseurs possèdent un MBA contre seulement 20% en France; 48% des investisseurs américains ont un diplôme en science contre 41% en France) et une prédominance de profils d’anciens banquiers ou d’investisseurs financiers (70% contre moins de 60% aux Etats-Unis). Enfin, dans les fonds français, les anciens entrepreneurs sont également moins présents (14%) par rapport aux fonds américains (18%), alors que des montants plus élevés sont levés par des investisseurs issus du secteur public, d’une grande école de commerce ou d’ingénieur. Enfin, les tickets investis restent encore trop faibles en moyenne : en France, les tickets moyens des capitaux-risqueurs sont près de 2 fois inférieurs de ceux pratiqués en Angleterre et près de 3 fois inférieurs à ceux de l’Allemagne sur le 1er trimestre 2017.
Le partenariat avec les grands groupes
“Il y a 25 ans, l’innovation des grands groupes était surtout une affaire interne, assez secrète et essentiellement concurrentielle. Depuis, le paradigme a changé : d’un modèle essentiellement fermé, les entreprises se tournent vers les logiques ouvertes et coopératives”.
Ce basculement prend des formes multiples : rachat de jeunes entreprises, concours de start-up, programmes d’accompagnement (incubation ou accélération), partenariats commerciaux avec des start-up, soutien business et technique…aujourd’hui 100% du CAC 40 a adopté l’une de ces formes partenariales. Pour 82% des entreprises, interagir avec des start up est une mission importante, voire urgente (pour 1/4 de l’échantillon).
Les entrepreneurs partagent cet avis, 70% d’entre eux ciblant directement les grands groupes dans leur politique commerciale. Les montants engagés ont également augmenté de façon exponentielle : 79 deals ont impliqué des corporate ventures en 2016, contre 55 l’année précédente, pour un montant cumulé de près de 1,4Md€, soit le triple des montants enregistrés en 2015 (550M€ de 2015). Le nombre de partenariats entre grands groupes, incubateurs et accélérateurs a été multiplié par 9 en 5 ans, celui des alliances entre start-up et fonds de corporate venture, par 56.
Les 100 meilleures entreprises du classement Forbes Global travaillent ainsi deux fois plus avec des start-up que les 100 dernières entreprises de ce même classement; la France est le pays dont les grands groupes collaborent le plus avec les start-up (devant les Etats-Unis ou l’Allemagne).
Plus généralement, le défi est de construire un nouveau modèle où les dirigeants sont capables d’assumer un leadership ambidextre. Ce type de leadership doit en effet permettre d’assurer à la fois l’exploitation du business existant, mais aussi l’exploration de nouvelles innovations radicales.
Toutes ces initiatives d’innovations ouvertes ne peuvent fonctionner si les grands groupes n’adoptent pas eux-mêmes une culture et des compétences entrepreneuriales. Il n’est pas possible de collaborer avec des start-up comme avec des entreprises traditionnelles. Pour relever ce défi, les grandes entreprises lancent aussi de nombreux programmes d’intrapreneuriat. Souvent en effet, l’écueil réside dans l’incompatibilité des deux cultures d’entreprise, à tous les échelons de la hiérarchie. Certaines entreprises l’ont bien compris et ont décidé de recruter de nouveaux responsables, ayant acquis une expérience entrepreneuriale au cours de leur vie professionnelle. Toutes ces évolutions transforment le modèle de gestion traditionnel : du management classique caractérisé par une ligne hiérarchique et des processus fiabilisés, au leadership entrepreneurial, horizontal et adaptatif.
Et dans 25 ans
“En 25 ans, toutes les parties prenantes du pays se sont lancées dans une myriade d’actions et d’initiatives pour rendre l’économie plus entrepreneuriale. Aujourd’hui, les résultats sont étonnants et très encourageants. Cependant, le slogan « tous entrepreneurs » ne peut seul assurer un développement économique et social harmonieux dans le pays. Plus que l’enjeu de la création d’entreprise lui-même, il faut travailler sur trois leviers complémentaires :
-il faut substituer à la vision quantitative une vision qualitative, en soutenant préférentiellement les acteurs susceptibles de devenir les futures entreprises de taille intermédiaire et les nouvelles grandes entreprises françaises.
-Trouver de nouvelles solutions pour permettre aux indépendants et aux patrons de microentreprises d’être mieux protégés des risques de la vie (santé, vieillesse, chômage…). Les réponses peuvent venir du public (refonte du RSI, évolution du statut d’auto-entrepreneur) comme du privé (nouveaux modèles de portage salarial, systèmes de coopératives). Sans protection adaptée, la vague entrepreneuriale risque de se traduire par une paupérisation et une précarisation.
-Penser l’évolution du management dans les grands groupes et les administrations publiques. Un modèle d’organisation, d’inspiration entrepreneuriale peut en effet offrir les moyens de piloter la disruption avec davantage d’agilité, et ce, dans une perspective de développement soutenable à la fois pour l’environnement et les salariés.