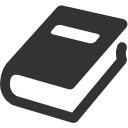Source : les données sont issues de l’enquête annuelle sur les investissements dans l’industrie pour protéger l’environnement (Antipol).
L’enquête concerne les 23 000 établissements de 20 salariés ou plus, implantés en France, appartenant aux secteurs des industries extractives, manufacturière et de la production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur d’eau et d’air conditionné (divisions 05 à 35 de la NAF rév. 2). 11 500 établissements ont été interrogés pour cette enquête.
Si le nombre des entreprises concernées est en léger recul, les dépenses engagées pour réduire leur impact environnemental (3,1Md€ en 2023) augmentent fortement (+13%).
⇒ Si le nombre d’entreprise est en léger recul par rapport à 2022 (54 vs 58%), elle est en forte progression en ce qui concerne les montants investis par rapport à 2019 (38%).
54% des 23 000 établissements industriels employant 20 salariés ou plus réalisent des investissements ou des études pour protéger l’environnement, que ce soit dans le domaine de la gestion de l’eau, de la gestion des déchets, des économies d’énergie ou encore de la protection de l’air et du climat sources.
♦ Les investissements y sont 6% de l’ensemble des investissements en installations techniques, matériel et outillage industriels.
♦ En montants d’investissements augmentent de 13% en 2022 et 2023 : ceux antipollution (2,651Md€) de 16% et de 43% entre la moyenne 2016-2021, tandis que les dépenses consacrées aux études (284M€ en 2023) baissent de 2% vs +6% au regard de la moyenne 2016-2021.
Noter que la moyenne des investissements de la période 2006-2009 était plutôt élevée (respectivement 2 187€ et en études 361M€) notamment comparés à la période 2016-2022, intégrant la période Covid (1 857M€ et 404M€).
♦ 46% des montants investis (1,232Md€), visant à réduire l’impact environnemental de l’activité industrielle, sont dédiés à l’énergie :
– Pour baisser la consommation d’énergie (664M€, le 1/4 des investissements, en hausse de 15%) : investissements dans des machines de production moins énergivores ou des systèmes de pilotage pour optimiser la consommation, travaux d’isolation des bâtiments,
– Pour la production d’énergie d’origine renouvelable (568M€, 21% des investissements antipollution et +25%) : l’augmentation est particulièrement forte pour les installations solaires (196M€, +88%) et, dans une moindre mesure, pour les pompes à chaleur (39M€, +26%), mais la production d’énergie à partir de biomasse ou de méthaniseurs reste le premier poste d’investissement (315M€, +7 %).
♦ Dans les autres domaines que l’énergie, les montants investis restent moindres mais peuvent être très dynamiques, comme ceux liés au recyclage des déchets (222M€, +58%), au paysage et à la biodiversité (178M€, +42%) via l’enfouissement de lignes électriques, l’installation de balises avifaunes pour protéger les oiseaux, la création d’espaces verts en lien avec des initiatives locales, pour la gestion de l’eau (146M€, +27%) par la rénovation de réseaux vétustes et la mise en place de circuits fermés ou le traitements des eaux usées (2,72M€, +13%). A l’inverse, les investissements diminuent dans les domaines de la protection des sols (1,37M€, -30%) et de la protection de l’air et du climat (2,97M€, -13%).
♦ En ce qui concerne les études (284M€ en 2023) : elles sont principalement destinées à l’énergie (36%), l’eau (16,5%), la protection de l’air (15%), les déchets (8%).
⇒ Les investissements selon le secteur d’activité et la taille des établissements.
♦ Les 2/3 des dépenses environnementales industrielles sont concentrées dans 4 secteurs : celui de la production et de distribution d’énergie (26%), l’agroalimentaire (16%), la chimie (12%) et la métallurgie (12%).
Les établissements du secteur de la production et de la distribution d’énergie consacrent un tiers de leurs dépenses (hors études réglementaires) aux énergies renouvelables et un cinquième à la préservation de la biodiversité.
Dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie et de la métallurgie, les économies d’énergie, et la gestion des eaux usées constituent les principaux postes de dépense.
Dans la métallurgie, la part des dépenses portant sur la protection de l’air et le recyclage des déchets est deux fois plus élevée que dans les autres secteurs (19%, contre 9).
♦ Les dépenses antipollution sont plus fréquentes dans les grands établissements :
93% des établissements de 500 salariés vs 44% les 20-49 salariés.
– Le montant moyen dépensé pour un investissement antipollution varie selon la taille de l’établissement : de 84 000€ pour les 20-49 salariés à 1,5M€ pour les plus de 500 salariés. Ainsi, si les établissements de 500 salariés ou plus ne représentent que 2% des établissements, ils concentrent 24% des dépenses.
– 8% des grands établissements disposent d’au moins une personne dédiée pour tout ou partie aux activités de protection de l’environnement et 64% ont au moins un spécialiste extérieur dédié à l’environnement. Pour les 20-49 salariés, ces parts sont nettement moins élevées (respectivement 33 et 9%).
Affecter aux activités de protection de l’environnement un spécialiste dédié est plus courant au sein des grandes entreprises du secteur de la chimie (85%) et des industries agroalimentaires (79%).
⇒ 19% des établissements bénéficient d’une aide publique.
5 principaux dispositifs d’aides publiques couvent en moyenne 30% des investissements ou études :
– Les aides de l’ADEME, qui soutiennent des projets innovants dans la transition énergétique (23% du nombre des aides versées en 2023).
– Les aides des agences de l’eau (19%), finançant la réduction de la pollution des milieux aquatiques, la protection de la ressource en eau ainsi que la modernisation des réseaux d’assainissement et la prévention des pollutions diffuses,
– le Certificat d’économies d’énergie (14%), incitant les fournisseurs d’énergie à financer des travaux d’économie d’énergie.
– Enfin, les aides régionales (10%) en soutien local selon les spécificités territoriales,
– Et le plan France Relance (7%) a été lancé en 2020 pour stimuler la transition énergétique après la crise sanitaire.
Pour en savoir davantage : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8636794