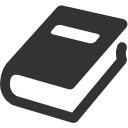Source : l’enquête microentrepreneurs est un dispositif permanent d’observation d’une génération de nouvelles entreprises, tous les 4 ans. Le champ de l’enquête couvre 214 000 microentrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018. L’échantillon utilisé est composé de 56 000 microentrepreneurs qui ont été enquêtés à trois reprises, fin 2018, fin 2021 et fin 2023. Seules les unités toujours actives économiquement ont été enquêtées pour cette 3éme vague.
Le 1er janvier 2018, les plafonds de chiffre d’affaires permettant l’accès au régime fiscal de la microentreprise et du régime micro‑social ont doublé (170 000€ pour une activité de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement, et 70 000€ pour une activité de services. Depuis 2023, ils sont respectivement de 188 700€ et 77 700€. La comparaison avec l’enquête 2014 doit tenir compte de cet important changement.
Définitions : un microentrepreneur bénéficie du régime de même nom (appelé autoentrepreneur jusqu’en 2014), qui offre des formalités de création d’entreprise allégées et un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Le taux de pérennité à N ans est le rapport entre le nombre de microentrepreneurs immatriculés sur une période donnée encore actifs N années après leur immatriculation et l’ensemble des microentrepreneurs immatriculés sur cette même période ayant effectivement démarré leur activité.
Le taux de démarrage est le rapport entre le nombre de microentrepreneurs immatriculés sur une période donnée qui ont effectivement démarré leur activité économique et l’ensemble des micro entrepreneurs immatriculés sur cette même période.
La proportion de microentrepreneurs actifs à N années est le rapport entre le nombre de microentrepreneurs immatriculés sur une période donnée encore actifs N années après leur
immatriculation et l’ensemble des microentrepreneurs immatriculés sur cette même période (qu’ils aient démarré leur activité ou non).
Les pérennes économiques qui ont le plus investi dans leur projet (capitaux initiaux, demandes de conseil, l’activité exercée à titre principal) ont les plus favorables taux de pérennité, à conjuguer avec l’activité exercée.
⇒ Une vision globale.
♦ En 2018, 750 000 entreprises ont été créées en France, dont 53% sous le régime du microentrepreneur ; 70% ont démarré leur activité, c’est‑à‑dire déclaré au moins un chiffre d’affaires non nul durant les 8 trimestres suivant l’immatriculation. Parmi eux, 39% sont pérennes “administratifs” à 5 ans (au regard de leur immatriculation toujours en cours) mais seulement 28% sont encore actifs économiques à 5 ans. A titre de comparaison, le taux de pérennité à cinq ans des entreprises individuelles autres atteint 63%, celui des sociétés 71%.
De l’ordre de 3 à 5% ne sont plus microentrepreneur parce qu’ils ont changé de statut juridique (société ou entrepreneur individuel « classique »).
♦ Les taux de pérennité des microentrepreneurs immatriculés en 2018 sont supérieurs à ceux de la cohorte 2014 avec un taux de démarrage de 66%, 33% pérennes “administratifs” à 5 ans, et 22% encore actifs économiquement. Rappelons qu’en 2018, les seuils maximaux de chiffre d’affaires des microentrepreneurs ont doublé, permettant des projets plus ambitieux en matière de chiffre d’affaires et des chances de pérennité plus fortes.
⇒ Taux de pérennité des actifs économiques selon les caractéristiques de leur dirigeant.
♦ Selon son âge : 51% ont au plus 35 ans, vs 26% les 45 ans et plus.
Pourtant, les 45-59 ans ont les taux les plus élevés (38%), devant les 35-44 ans (33%) et les 60 ans et plus (32), alors que les plus jeunes, plus nombreux ont les taux les plus faibles (13% les moins de 25 ans et 25% les 25-34 ans) ; ces derniers ont aussi les taux de démarrage les plus faibles (57 et 69% vs 73-81% pour les autres âges).
♦ Selon les niveaux de diplôme : 48% sont issus de l’enseignement supérieur, 29% au plus le CAP/BEP et 21% le bac.
Les taux de pérennité des actifs sont plus élevés pour ceux issus de l’enseignement secondaire, dont le bac (entre 40 et 44%, hors le bac général 34) vs 39% pour le supérieur.
Par contre le démarrage de l’activité les concerne tous (entre 70 et 73%), alors que les sans diplôme et ceux de niveau bac général sont moins fréquents (65 et 66%) ; ce n’est souvent pour ces derniers qu’une étape dans leur cursus de formation.
♦ Selon leur situation antérieure : 44% étaient en emploi et 26% au chômage : peu étaient étudiants (12%) ou sans activité professionnelle, dont retraité (12%), voire chef d’entreprise (6%).
Le taux de pérennité est assez proche pour ces situations différentes (27-34%), sauf pour les étudiants (15%), en situation souvent transitoire ; ces derniers ont d’ailleurs des taux de démarrage plus faibles (62% vs 69-74 pour les autres).
♦ Selon leur sexe : si les hommes sont plus nombreux (63%), ce sont les femmes qui ont les taux les plus élevés de pérennité (34% vs 24) et de démarrage (76% vs 66).
Elles sont en effet plus nombreuses dans les secteurs de la santé humaine, des activités de services aux ménages, dans l’industrie (métiers d’art) et l’enseignement.
♦ 64% disent avoir bénéficié de conseils ; ils affichent des taux de pérennité les plus élevés (30 vs 23 pour ceux qui n’ont las fait appel) ; idem pour les taux de démarrage (73% vs 65).
⇒ Taux de pérennité des actifs économiques selon les caractéristiques de leur entreprise.
♦ Selon la localisation des entreprises : 30% le sont en Ile-de-France, mais ce sont les autres régions qui affichent les taux de pérennité les plus élevés (30% vs 20) et ceux de démarrage (71% vs 61).
♦ Selon les capitaux réunis au démarrage : la moitié n’a réuni aucun capital (vs 37% au moins 500€), a moins souvent démarré une activité (64% vs 71-77 les autres tranches de capitaux) et fait état du taux le plus faible de pérennité (23% vs 28-34). Noter que eux qui ont réuni au moins 500€ (ceux qui ont le plus investi dans leur projet), sont aussi ceux qui ont le taux de démarrage le plus élevé (77%) ; idem pour le taux de pérennité (43 et44% vs 36-39).
♦ Les secteurs d’activité : 7 secteurs ont les taux de pérennité les plus élevés (entre 32 et 46% vs 8 à 27 les autres activités) et les taux de démarrage les plus marquants (73 à 82% vs 49-72 les autres secteurs) ; on y trouve nombre d’activités de service : la santé/action sociale (46% mais 50 la santé), les services aux ménages (41), l’enseignement (36), les services administratifs et de soutien aux entreprises (33), les activités récréatives (32) mais aussi l’industrie (43) et la construction (36).
Les transports par contre ont des taux trés faibles (8%, dont 6 la livraison à domicile), tout comme son taux de démarrage (49 vs 62-82 les autres).
Le secteur d’activité est le facteur le plus déterminant des chances de pérennité, devant les caractéristiques sociodémographiques du microentrepreneur et les autres caractéristiques du projet.
⇒ Quelques compléments sur les modalités d’exercice de l’activité.
♦ 53% des pérennes économiques exercent ce métier à titre principal ; ils connaissent les taux de pérennité les plus élevés (33% vs 23 pour ceux qui n’y ont pas recours à titre principal), ainsi que le taux de démarrage (78 vs 64).
♦ 36% ont par ailleurs une autre activité rémunérée (23% à temps complet et 12% à temps partiel) : ceux rémunéré par ailleurs à temps complet ont le plus faible taux de pérennité (18% vs 30 la fois pour une autre rémunération à temps partiel, et pour aucune autre rémunération) et le plus faible taux de démarrage (58% vs 72-74).
♦ Le montant de chiffre d’affaires annuel ; en moyenne 20K€.
– De 20 à 29K€, ce sont les HCR (29K€) et le commerce (21), la construction (28) et les services dont aux entreprises (entre 20 et 25), les activités immobilières (26) et financières (25).
– Entre 11 et 15K€, on y trouve l’industrie (dont le métiers d’art), l’enseignement, les services aux ménages, les activités récréatives et le transport.
– 25% affichent au plus 3 490€ annuels vs 25% des plus hautes rémunérations 28 275€ et les 10% des plus hautes rémunérations 48 000€ ; la médiane des rémunérations chiffre 12 348€ et la moyenne 19 571€.
– Le ratio entre revenu d’activité et chiffre d’affaires est estimé à 53% en moyenne, à partir des
abattements représentatifs des frais professionnels réalisés par la DGFiP, soit un revenu annuel de 10 000€, équivalent à 60% du SMIC net annuel.
– Les 62% de microentrepreneurs encore actifs fin 2023 dont l’activité de microentrepreneuriat est l’activité principale déclarent en moyenne 25 000€ de chiffre d’affaires. 44% d’entre eux ont une autre source de revenus, le plus fréquemment le revenu d’un conjoint (dans 44 % des cas) ou des prestations sociales ou indemnités (39%).
Les 38% qui exercent en activité de complément déclarent en moyenne 11 000€ de chiffre d’affaires ; pour 64%, l’activité de microentrepreneur est ponctuelle. Ils disposent d’une autre source de revenus, majoritairement un salaire (58%) ou une pension de retraite (25%).
61% des actifs fin 2023 sont satisfaits de leur chiffre d’affaires.
⇒ Entre 2020 et 2022, pendant la crise sanitaire.
Si la pérennité des projets n’a pas baissé, les chiffres d’affaires ont été affectés : 66% de la cohorte 2018 encore actifs fin 2021 ont connu un chiffre d’affaires moindre qu’espéré, 9% ont même perdu tout leur chiffre d’affaires.
Le secteur de l’informatique et de la communication a été le moins concerné : 55% ont vu leur chiffre d’affaires réduit contre 83% de ceux du secteur des arts, spectacles et activités récréatives (21% ont même temporairement arrêté leur activité durant cette période). 6 sur 10 ont connu des difficultés financières, 4 sur 10 le manque de débouchés et de commandes, un sur 10 des difficultés d’approvisionnement (4 sur 10 dans la construction, 2 sur 10 dans l’industrie) et 1 sur 10 des fermetures administratives liées aux mesures sanitaires en concernent un sur dix (2 sur 10 dans les activités tournées vers les ménages, l’enseignement et les arts, spectacles et activités récréatives).
La moitié ont perçu des aides liées à la crise sanitaire (fonds de solidarité pour 4 sur 10, report des échéances fiscales et sociales 1 sur 10). Les secteurs les plus aidés ont été les HCR et les services aux ménages.
♦ microentrepreneurs et recours aux plateformes.
Parmi les micro‑entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2018 et encore actifs fin 2023, 9% travaillent par l’intermédiaire d’une ou plusieurs plateformes numériques de mise en relation (5 points de moins que l’année de leur immatriculation.
67% le font dans la livraison à domicile (contre 53% fin 2018), 18% dans les HCR, 17% dans l’édition et l’informatique.
70% de ceux qui les utilisaient comme principale source de chiffre d’affaires en 2018 ne travaillent plus avec en 2023. À l’inverse, seuls 7% de ceux qui travaillaient sans en 2018 les utilisent 5 ans après ; le secteur de la livraison fait exception (si 27% les ont abandonnées, 56% de ceux qui travaillaient sans en 2018 travaillent avec en 2023).
Parmi les micro‑entrepreneurs qui utilisent ces plateformes, 54% le font pour gagner en visibilité et 48% considèrent qu’il est difficile d’accéder aux marchés sans. 36% déclarent
que l’usage des plateformes permet d’accroître l’activité et 17% que cela évite d’avoir à développer un site ou une application.
Pour en savoir davantage : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8634000