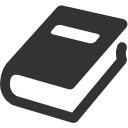Méthodologie : la réalisation d’un tel exercice, nécessite un important travail de nettoyage et de mise en cohérence des données issues de différentes sources. Le champ d’analyse a été restreint à un nombre limité de variables, sélectionnées pour leur cohérence et pour leur comparabilité entre les deux définitions de l’entreprise retenues (unité légale versus entreprise au sens de la loi de modernisation de l’économie – LME).
Les données proviennent du fichier complet et unifié de SUSE (Système unifié de statistiques d’entreprises) qui fournit des informations économiques et comptables sur les entreprises entre 1994 et 2007. Ce fichier est issu de 2 sources : la liasse fiscale et l’enquête annuelle d’entreprises (EAE). Depuis 2008, un seul dispositif existe : l’Élaboration des statistiques annuelles d’entreprises (ESANE). Ces bases de données couvrent l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
L’observation des entreprises sous la forme juridique unités légales ou sous la forme économique de LME conduit à un regard différent en ce qui concerne la pluralité des tailles d’entreprise. Elle permet de prendre recul avec les fortes hausses souvent annoncées pour valoriser les ETI.
⇒ Évolution du tissu productif français des PME-ETI sur la période 1994-2022 :
Entre 1994 et 2022, le nombre d’ETI unités légales (ETI-UL) a oscillé entre 4 000 et 5 000 unités, tandis que celui des ETI-LME est passé de 2 800 à plus de 4 300 unités.
♦ L’évolution de ces deux catégories d’ETI peut être décomposée en 5 grandes phases : une croissance marquée entre 1994 et le début des années 2000, suivie d’une relative stabilité entre 2001 et 2007, puis la crise financière de 2008 avec une forte baisse, ramenant le nombre d’ETI à un niveau proche de celui du milieu des années 1990, une situation qui perdure jusqu’à la crise du Covid, avec donc une stabilité entre 2009 et 2019 et enfin, la période 2020-2022 avec une reprise notable (les ETI-UL franchissant de nouveau le seuil des 5 000 unités pour la 1ére fois depuis 2008, et les ETI-LME dépassant pour la 1ére fois le seuil des 4 000 unités).
♦ Cette dynamique est comparable à celle des PME.
Entre 2009 et 2015, le nombre de PME-UL est resté proche de son niveau du milieu des années 90, avant de repartir à la hausse dès 2016, avec une forte accélération à partir de 2021. En revanche, pour les PME-LME, bien que la reprise ait également débuté en 2021, elle n’a pas permis de retrouver le niveau de 2007, qui reste le plus élevé observé sur la période. Sur l’ensemble de la période étudiée, le nombre de PME-UL est passé de 132 222 unités en 1994 à 180 167 en 2022 (+36,4%), alors que la hausse des PME-LME, n’augmente que de 7,6% (de 119 980 à 129 065 unités).
Enfin le nombre de GE-LME est passé de 118 unités en 1994 à 199 unités en 2022 (+68,6%), quand le nombre des GE-UL est passé de 73 unités à 114 unités (+56,2%).
Ces évolutions du nombre d’entreprises au sens LME provient notamment d’entreprises de taille inférieure absorbée dans une taille supérieure.
♦ S’agissant de l’effectif salarié : en 1994, les ETI-UL employaient près de 3 millions de salariés, contre un peu plus de 2,2 millions pour les ETI-LME. Cet écart d’environ 800 000 salariés n’est plus que de 500 000 salariés en 2022.
En 2022, les PME-UL comptabilisent près de 6 millions de salariés, contre seulement 4 millions après le passage à la définition de la LME. Cette différence s’explique par le fait que 17% des PME-UL (près du 1/3 de l’emploi des PME-UL), ont changé de catégorie ; de fait, 13% des PME-UL, représentant 22% de l’emploi de cette catégorie, ont été rattachées à (ou ont formé) des groupes de taille ETI-LME et 4%, représentant 10% de l’emploi des PME-UL, se sont rattachées à des groupes de grande taille (GE-LME).
Entre 1994 et 2022, l’emploi des GE-LME a progressé de 30% (de 3 à 3,9 millions de salariés).
Alors que la répartition de l’emploi entre les PME-UL, les ETI-UL et les GE-UL oscillait autour de 50%, 30 et 20, la situation diffère sensiblement avec l’approche LME. Le poids des ETI LME a connu une progression passant de 25% en 1994 à 30% en 2022, tandis que celui des GE-LME s’est stabilisé autour de 35%. En revanche, la part des PME-LME a reculé, passant de plus de 40% en 1994 à 35% en 2022.
Par ailleurs, la contribution des ETI-UL à la valeur ajoutée des unités légales de plus de 10 salariés est passée de 34% en 1994 à 40% en 2022 ; pour les ETI-LME, cette augmentation passe de 25% en 1994 à 33% en 2022.
Celle des PME-LME a connu une diminution quasi continue, passant d’un point haut de 34% en 1994 à 28% en 2022.
♦ La définition de la LME, en agrégeant les unités légales appartenant à un même groupe, met en lumière des dynamiques jusque-là invisibles :
– Sur le nombre d’entreprises, elle se traduit par une baisse moyenne sur la période de 50 grandes entreprises, 1 000 ETI et environ 30 000 PME.
– Sur le poids dans les effectifs salariés, elle atténue les écarts entre les trois catégories : alors que la répartition initiale était en moyenne de 50% pour les PME, 30% pour les ETI et 20% pour les grandes entreprises, elle devient 37, 28 et 35%.
⇒ La productivité apparente du travail :
La productivité des ETI-UL a augmenté de 50% sur la période 1994-2022 (un taux de croissance annuel moyen de 1,4%). Pour les PME-UL, la progression du taux de croissance est plus modérée (0,8% par an), tandis que les GE-UL enregistrent une baisse moyenne de 0,6% par an.
Avec l’approche LME, le taux de croissance annuel moyen s’établit à 0,8% pour les GE-LME, 1,1% pour les ETI-LME et 0,7% pour les PME-LME, avec une moyenne toutes entreprises à 1.
Quelle que soit l’approche retenue (unités légales ou entreprises au sens de la LME) les ETI restent la catégorie dont la productivité a le plus progressé entre 1994 et 2022.
⇒ L’intensité capitalistique.
L’intensité capitalistique, définie comme le rapport entre le capital et le travail indique qu’une entreprise utilise plus de capital par travailleur.
Sur l’ensemble de la période étudiée, l’intensité capitalistique progresse pour toutes les catégories d’unités légales, un phénomène qui traduit un renforcement des investissements en capital au fil du temps. Cependant, cette dynamique de croissance varie fortement selon la taille de l’unité légale : les GE-UL affichent l’intensité capitalistique moyenne la plus élevée, avec des écarts pouvant atteindre 100 000€ par salarié par rapport aux ETI-UL ; cependant, ces écarts sont nettement plus faibles à la médiane et au niveau des quartiles.
De leur côté, les PME-UL, bien qu’en progression, conservent une intensité capitalistique nettement plus faible et une évolution plus modérée que celle observée pour les ETI-UL et les GE-UL.
⇒ Distribution des PME/ETI selon leur effectif et leurs contributions à l’emploi et à la valeur ajoutée.
85% des PME-UL comptent entre 10 et 50 salariés, avec une forte concentration dans la tranche 10-30 salariés (près de 70%) qui représente 32% de la valeur ajoutée et 35% de l’effectif salarié des PME-UL.
On observe une relation inverse entre les tranches d’effectifs et ces trois indicateurs : plus la taille des PME est importante, moins le nombre d’unités légales est élevé et plus leur contribution à la valeur ajoutée et à l’effectif salarié des PME diminue.
La tranche la plus productive est celle qui correspond à l’intervalle 30-50, son poids dans la valeur ajoutée étant supérieur à son poids dans l’effectif salarié. À l’inverse, la tranche 10-30 apparaît comme la moins productive. Les autres tranches présentent des niveaux de productivité relativement homogènes, les écarts entre leur contribution à la valeur ajoutée et à l’effectif salarié étant limités.
Le passage à la vision économique de la LME ne modifie pas ces résultats : concernant les ETI, 85% ont un effectif inférieur à 1 000 salariés réalisant 49% de la valeur ajoutée et accaparant 56% de l’effectif salarié. Contrairement aux PME, où la relation inverse entre les tranches d’effectifs et les trois indicateurs étudiés (nombre d’ETI, poids dans la valeur ajoutée et poids dans l’effectif salarié) est clairement établie ; cette relation apparaît moins évidente pour les ETI-LME, en particulier au delà du seuil de 2 250 salariés. En outre, à l’instar des PME, la première tranche (250-500) apparaît comme la tranche la moins productive, même si l’approche économique au sens de la LME permet de réduire l’écart de productivité de cette tranche avec le reste de la population des ETI-LME.
Entre 1994 et 2022, l’approche juridique suggère une prépondérance des PME-UL, suivies des ETI-UL et enfin des GE-UL, avec des poids globalement stables dans le temps. En revanche, l’approche économique révèle une hiérarchie inversée entre les PME-LME et les GE-LME et souligne que la catégorie la plus dynamique sur cette période est celle des ETI-LME, avec une part dans l’emploi et dans la valeur ajoutée qui augmentent de 5 et 8 points de pourcentage respectivement. Au sein de cette catégorie, l’activité se concentre en grande partie sur les entreprises de moins de 1 000 salariés, qui représentent 78% des ETI-LME, réalisent 42% de la valeur ajoutée et accaparent 45% de l’emploi. De même, parmi les PME-LME, les entreprises de moins de 50 salariés sont les plus nombreuses (86% des PME-LME), génèrent 51% de la valeur ajoutée et représentent 54% de l’emploi.
⇒ Quid de l’hétérogénéité sectorielle pour les ETI et les PME ?
♦ Entre 1994 et 2022, l’évolution du nombre d’ETI-LME dans l’industrie, ainsi que celle de leurs effectifs, suit une dynamique en 4 phases distinctes :
– La 1ére, entre 1994 et 1998, est caractérisée par une stabilité, avec environ 1 250 ETI-LME industrielles,
– La 2éme phase, de 1998 à 2001, correspond à une période de croissance du nombre d’ETI-LME, qui enregistre une augmentation de 17% (passant de 1 256 à 1 470 unités),
– La 3éme phase, s’étendant de 2001 à 2011, est caractérisée par une baisse continue, accentuée par la crise économique de 2008, qui a accéléré la contraction du nombre d’entreprises et de leurs effectifs,
– La 4éme phase se distingue par une stabilité prolongée qui a duré 10 ans (entre 2011 et 2020), avant qu’une reprise ne s’amorce à partir de 2021, permettant ainsi de retrouver un nombre d’ETI-LME industrielles et d’emplois salariés comparable à celui de 1994 (soit 1 230 ETI-LME et près d’un million d’emplois industriels),
L’évolution des PME suit une trajectoire sensiblement différente. Après une hausse modérée entre 1994 et 1998, le nombre de PME-LME a poursuivi son déclin de manière quasi ininterrompue jusqu’en 2020, accéléré par la crise de 2008. Cette diminution ne s’explique pas par les réaffectations liées à l’application de la loi LME, puisqu’en adoptant l’approche juridique, la baisse du nombre de PME-UL industrielles et de leur emploi apparaît simplement décalée au début des années 2000 au lieu de 1998 pour les PME-LME.
♦ Le secteur des services renvoie une image de croissance quasi continue du nombre des PME/ETI et de leurs effectifs entre 1994 et 2007. Toutefois, entre 2008 et 2022, les trajectoires des PME-LME et des ETI-LME divergent. Alors que l’évolution des PME-LME suit une dynamique en forme de U, avec un point bas en 2015 à 65 528 unités avant de retrouver un niveau proche de celui de 2007 (86 944 unités), la trajectoire des ETI-LME est caractérisée par une croissance continue. Cette progression s’est même accélérée en 2020, permettant au nombre d’ETI-LME de dépasser le seuil de 2 500 unités dès 2021 et un emploi salarié qui dépasse les 2,2 millions.
⇒ L’ampleur de la désindustrialisation est plus marquée chez les PME-LME.
Dans le secteur industriel, la répartition des effectifs entre les PME-UL et les ETI-UL demeure stable sur la période 1994-2022, oscillant en moyenne autour de 48% pour les premières et de 40% pour les secondes. Cette stabilité montre que la réduction globale des effectifs industriels affecte de manière proportionnelle ces deux catégories d’entreprises. Autrement dit, bien que le volume total d’emplois industriels diminue, la structure relative de l’emploi entre PME-UL et ETI-UL reste inchangée, reflétant une contraction homogène du secteur. Toutefois, cette stabilité s’estompe lorsqu’on adopte l’approche économique de la loi LME. Dans ce cas, la part des PME-LME dans l’emploi industriel diminue, tandis que celle des ETI-LME progresse.
On retrouve, avec des ordres de grandeur plus faibles, ces mêmes résultats avec la valeur ajoutée industrielle. Entre 1994 et 2022, le poids des PME-LME dans la valeur ajoutée industrielle a baissé de 6,4 points de pourcentage, soit un recul proche de celui enregistré dans le secteur des services (7,1 points).
À l’inverse, la contribution des ETI LME à la valeur ajoutée industrielle a progressé de 5,4 points de pourcentage et de 6,2 points de pourcentage à la valeur ajoutée du secteur des services.
En conclusion, selon la définition LME, la désindustrialisation a affecté davantage les PME que les ETI, puisque le poids des PME-LME dans l’activité industrielle (emploi et valeur ajoutée) a baissé alors que le poids des ETI-LME a progressé.
⇒ Les secteurs les plus affectés par des changements de structure de taille des entreprises.
Entre 1994 et 2022, seuls deux sous-secteurs industriels enregistrent une évolution de plus de 10 points de pourcentage dans l’emploi total des ETI-LME : la fabrication d’autres produits industriels14 (+12,5 pp) et la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines (+10,8 pp). À noter que dans le sous-secteur des matériels de transports, la part des ETI a reculé de 10 points entre 1994 et 2016, avant de rebondir de 6,6 pp.
Dans le secteur des services, le poids des ETI-LME dans l’emploi a connu une progression particulièrement marquée entre 1994 et 2022 dans trois sous-secteurs : l’Information et communication (+12,2 pp), le commerce, réparation d’automobiles (+10 pp) et les services aux entreprises15 (+7,2 pp). S’agissant de ce dernier sous-secteur, il convient de souligner que le nombre d’ETI-LME est passé de 421 en 1994 à 904 en 2022, les deux tiers de cette hausse s’étant concentrés sur la période 2018 à 2022.
En conclusion, plusieurs études montrent que les ETI ont une orientation plus industrielle que les PME, davantage tournées vers les services.
L’approche économique révèle une progression significative de la contribution des ETI-LME à l’emploi et à la valeur ajoutée entre 1994 et 2022, atteignant environ 7 points pour la valeur ajoutée et les 6 points pour l’emploi. À l’inverse, le poids des PME-LME a reculé de 5,6 points en termes de valeur ajoutée et de 6,1 points en matière d’emploi. S’agissant des GE, leur contribution à la valeur ajoutée a baissé de 1,3 point, tandis que leur part dans l’emploi a progressé légèrement (+0,3 point).
En distinguant le secteur des services de celui de l’industrie, on observe que la contribution des ETI-LME à l’emploi et à la valeur ajoutée a augmenté de manière dynamique dans les deux secteurs. La progression la plus modérée concerne la valeur ajoutée industrielle (+5,4 points), tandis que la hausse la plus marquée s’observe dans l’emploi des services (+7,7 points).
Au cours des trois dernières décennies, contrairement aux PME-LME, qui ont été fortement affectées par la désindustrialisation, les ETI-LME ont fait preuve de résilience notable. Cette capacité d’adaptation se révèle toutefois moins prononcée pour les grandes entreprises.
⇒ La démographie des ETI
Après avoir analysé les évolutions structurelles des ETI et PME, tant au niveau national que sectoriel, on explore ici la dynamique des transitions au sein de la catégorie ETI. Cette section examine les entrées et sorties de cette classe de taille, ainsi que les trajectoires d’évolution des ETI vers d’autres statuts, qu’il s’agisse d’un passage au statut de PME ou de GE, d’une cession, d’une défaillance ou d’une cessation d’activité.
Cette analyse repose exclusivement sur l’approche juridique en unité légale.
3 sources principales d’entrée sont distinguées :
– Les nouvelles entrées dans la base (les créations ex nihilo qui apparaissent dans la catégorie des ETI sans transition depuis une autre classe,
– Les PME devenant des ETI généralement par croissance interne ou externe,
– Les grandes entreprises (GE) devenant des ETI, généralement à la suite d’une restructuration ou d’une réduction d’effectifs.
On constate qu’à l’exception de 2008, entre 6% et 14% des ETI entrent pour la première fois dans ce statut chaque année. La majorité de ces transitions provient d’entreprises classées PME l’année précédente (entre 5,2% et 12%), alors que la transition depuis les grandes entreprises reste marginale (moins d’1%). Ainsi, l’évolution naturelle des PME vers le statut d’ETI est le principal facteur du taux de renouvellement des ETI.
Concernant les sorties du statut d’ETI, on observe plusieurs types de transitions : les ETI devenant TPE, les ETI devenant PME (en raison d’une réduction de leur activité impactant leur effectif), des entreprises qui disparaissent de la base, généralement en raison d’une fusion ou d’une restructuration, des défaillances et des ETI qui deviennent des GE (phénomène marginal).
Entre 4 et 11% des ETI sortent chaque année de ce statut. Ces sorties sont majoritairement des transitions vers le statut de PME (entre 4 et 8%). Les autres types de sorties, plus marginales (1à 5%) se répartissent : comme suit : restructurations ou fusions, sans lien systématique avec un déclin économique (1et 4% des ETI), défaillances (0,1 à 0,6%), transitions vers le statut de GE (0,1 à 0,5%).
⇒ Évolution des ETI : trajectoires de transition entre statuts sur 5 et 10 ans.
1/3 des entreprises classées comme ETI en 2022 avaient un statut différent 5 ans plus tôt ; parmi ces ETI, 6% étaient des TPE en 2017, 23% des PME (dont 20% d’entreprises de plus de 50 salariés et 3% de moins de 50 salariés), et 3% des créations.
2/3 des ETI de 2022 avaient déjà ce statut en 2017, et 55% l’avaient également en 2012 dix ans plus tôt. Ainsi, 45% des ETI de 2022 avaient un statut différent en 2012 : elles étaient ou bien des TPE (5%), ou bien des PME (29%, dont 25% d’entreprises de plus de 50 salariés et 4% de moins de 50 salariés), ou bien des entreprises créées (9%). entre 2012 et 2022 (9%).
L’analyse symétrique révèle que 80% des entreprises classées comme ETI en 2017 ont conservé ce statut en 2022, tandis qu’un cinquième ont changé de catégorie : 11% sont devenues des PME (9% ayant plus de 50 salariés et 3% moins de 50 salariés), 4% ont cessé leur activité, 2% sont devenues des TPE, 1% ont atteint le statut GE, 1% ont connu une défaillance.
Ces résultats montrent une transition des ETI vers les PME nettement moins fréquente que l’inverse sur la même période : 11% des ETI de 2017 sont devenues PME en 2022, soit un pourcentage deux fois inférieur à celui des ETI de 2022 ayant été PME en 2017 (23%).
Pour en savoir davantage : https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/quelle-dynamique-des-pme-et-des-eti-en-france-depuis-1994