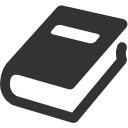L’ESS a évolué sans cadre juridique spécifique jusqu’à l’adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. L’Insee et la Banque de France ont instauré un suivi spécifique. La loi a renforcé l’instance nationale (Conseil supérieur de l’ESS ) et régionales (Chambres régionales de l’ESS pour accompagner la création d’entreprises, coordonner les actions de développement local et centraliser les données utiles au suivi statistique du secteur).
Un point est fait par le Trésor et la Cour des comptes.
⇒ Quelques points de repère.
♦ Quelques chiffres : les données du Trésor Eco (source Insee Flores 2019) sont quelque peu différentes de celles fournies par Avise ou par la Cour des Comptes : Avise, ESS France, comme la Cour des Comptes s’appuient sur des données plus récentes de l’Insee (2021 au lieu de 2019) : 2, 716M de salariés vs 2,634 pour le Trésor, 220 242 établissements employeurs vs. 207 894 et 152 979 entreprises vs 154 253.
♦ Et ailleurs qu’en France ?
Les premiers cadres législatifs consacrés à l’ESS sont apparus en Europe au début des années 2010 ; sont notamment concernés : l’Espagne, le Portugal, la Belgique, et l’Allemagne.
Hors d’Europe, plusieurs pays s’y consacrent : le Québec, le Mexique, la Corée, et en Afrique, le Cap Vert, le Cameroun et Djibouti, la Tunisie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. L’Assemblée générale de l’ONU (2023) a adopté une résolution qui définit officiellement l’ESS, souligne son rôle dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable et encourage à la fois les États et les banques de développement à déployer des financements dédiés.
⇒ Une vision globale selon l’étude du Trésor.
♦ En 2019, l’ESS emploie près de 2,6 millions de salariés (10,2% de l’emploi total et 13,6% de l’emploi salarié du secteur privé en France) avec 220 242 établissements employeurs ; au total, l’ESS compte 1 527 539 structures en incluant les structures sans salarié.
Le gouvernement a fortement accru le volume des emplois aidés en réponse aux crises à partir de 2008 : 502 000 contrats aidés (hors IAE) ont été signés en 2009 (+40% par rapport à 2008). Le même réflexe a prévalu lors de la pandémie de Covid-197 : le nombre d’entrées a plus que doublé entre 2020 et 2021 (+126%) pour atteindre 185 000 sur l’année 2021, tandis que le nombre de nouveaux contrats signés en IAE a augmenté de 29%.
♦ 5 formes juridiques concernent l’ESS : les associations, de loin la forme la plus habituelle regroupe 80% des établissements employeurs, et 77% des effectifs salariés ; suivent les coopératives avec 11% des établissements employeurs et 12% des effectifs.
♦ 3 secteurs concentrent les 2/3 des effectifs : l’action sociale, notamment l’hébergement (39,4%), l’enseignement (14%) et les activités financières et d’assurance (10,3 %). Dans l’action sociale et dans les sports et loisirs, l’ESS fournit plus de la moitié des emplois nationaux.
♦ L’ESS mobilise également 22 millions de bénévoles qui jouent un rôle structurant dans la vie associative et la cohésion territoriale, notamment dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
♦ Sa contribution à la production de richesse nationale est estimée à 6% de la valeur ajoutée brute créée en France en 2010.
♦ Le maillage territorial de l’ESS est dense mais variable : elle représente entre 15% de l’emploi total mais 25% dans certains départements ruraux (Lozère, Deux-Sèvres, Haute-Loire, Aveyron, Cantal), et seulement de l’ordre de 5% dans certains départements franciliens (Hauts-de-Seine, Seine-Saint Denis).
⇒ Les difficultés financières propres à l’ESS.
♦ Un accès difficile aux financements : les marges opérationnelles médianes plafonnent à 14,6%, contre 24,6% dans l’économie conventionnelle. Cet écart est largement imputable au poids des associations puisque les coopératives ne présentent pas de différences marquées avec le reste de l’économie (marges médianes de 22,2%). Cette rémunération limitée, conjuguée à des fonds propres structurellement faibles (capacité d’autofinancement inférieure à 7% des fonds propres pour les associations contre 14% dans le reste de l’économie), réduit l’autofinancement et renchérit le risque perçu par les prêteurs.
♦ Pourtant, les entreprises de l’ESS affichent un profil de risque favorable : 76% obtiennent une « bonne cotation » Banque de France contre 63% pour l’ensemble des entreprises cotées, et leur taux de défaut observé à 3 ans (1,19%) est inférieur de moitié environ à celui des entreprises conventionnelles. Les associations ne publient pas toujours de comptes standardisés, ce qui complique le suivi statistique et l’analyse du risque financier.
L’innovation sociale, qui consiste à apporter des solutions nouvelles (produits, services ou formes d’organisation) répondant mieux à des besoins sociaux ont difficulté de démontrer leur impact.
Les associations tirent principalement leurs ressources de leur activité (65%) et de subventions publiques (20%). Dans certains secteurs, comme le médicosocial ou le logement social à but non lucratif, une part des recettes provient d’activités soumises à tarification administrée pour garantir l’accessibilité du service public, conduit à réduire leurs marges.
♦ Le soutien de l’État à l’ESS sous forme de subventions (associations) et de dépenses liées à des prestations de services (plutôt les coopératives), chiffre 10 Md€ en 2022, avec prés de 120 000 versements publics pour 105 programmes budgétaires. En outre, l’État fournit un soutien indirect à l’ESS, notamment par le biais de dépenses fiscales et de contrats aidés, dont les coûts se sont élevés en 2022 à respectivement 4,5 Md€ et 1,15 Md€.
Près de 80% des subventions sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’État : l’hébergement d’urgence (18% des subventions en 2024), le soutien à l’enseignement privé et à l’éducation (15%), l’accompagnement social et l’aide alimentaire (13%), l’accueil et l’orientation des réfugiés et des demandeurs d’asile (12%).
Par ailleurs les collectivités locales, mais également les agences de l’État (telles l’Ademe qui a versé 6% de son budget), les organismes de la Sécurité sociale et les banques publiques (Banque publique d’investissement et Caisse des dépôts et consignations) contribuent à leur financement.
Ces modalités de financement renforcent leur exposition aux aléas de la dépense publique et peuvent compliquer le pilotage pluriannuel de leur financement.
♦ Des mécanismes de garantie bancaire ont été instaurés pour réduire le risque perçu par les établissements financiers et simplifier l’octroi de crédits aux acteurs de l’ESS. Parmi ces dispositifs, la « Garantie Impact », gérée par France Active et cofinancée par l’État, les régions et l’Union européenne, propose une garantie bancaire couvrant jusqu’à 65% du montant d’un prêt accordé à une structure de l’ESS en création (et 50% pour celles en développement), dans la limite de 100 000€ ; pour l’emprunteur, ce dispositif a un coût modéré (2,5% du montant du prêt).
♦ Des instruments financiers spécifiques ont été créés pour renforcer les fonds propres des structures de l’ESS, tels :
– Les titres associatifs pour lever des quasi-fonds propres auprès des investisseurs sans remettre en cause leur gouvernance désintéressée.
– Depuis 2020, le livret de développement durable et solidaire (LDDS) permet aux épargnants de faire don d’une partie de leurs dépôts aux acteurs de l’ESS sur proposition de leur banque (2 M€ réalisés en 2023). De plus, les établissements bancaires sont désormais tenus de diriger au moins 5% des encours non centralisés des livrets A et LDDS vers des projets ESS, soit 9 Md€. Le nombre de LDDS a augmenté de 9,5% entre 2020 et 2023 (26,6 millions en 2023), et les encours de +22,6% sur la même période, pour atteindre 149 Md€ en 2023.
– Tous les contrats d’assurance-vie multisupports doivent inclure au moins un fonds labellisé solidaire parmi leurs unités de compte. Si l’assurance-vie solidaire reste encore modeste, avec 3,5 Md€ investis (0,2% du total de l’assurance-vie), elle présente un fort potentiel de croissance, à mesure que l’offre de produits solidaires se développe et gagne en visibilité auprès des épargnants.
– Enfin, créé par la loi n° 2014-856, et accordé pour une durée de cinq ans, l‘agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) soutient les entreprises engagées dans une mission d’utilité sociale, comme l’accompagnement des publics vulnérables ou le renforcement de la cohésion territoriale. Seules les entreprises agréées ESUS peuvent accéder à certains fonds d’épargne solidaire. Depuis 2008, toute entreprise proposant un plan d’épargne salariale est tenue d’inclure au moins un fonds solidaire « 90-10 », qui depuis le 1er janvier 2025, investit entre 5 et 15% de ses actifs dans des entreprises agréées ESUS. Aujourd’hui, ces fonds représentent le principal canal de collecte de l’épargne solidaire, avec un encours de 18 Md€ fin 2023 (600 M€ en 2007), soit +2,7 Md€ en 2023 et +27,5% de hausse moyenne par an depuis 20 ans. Souscrire au capital d’une entreprise agréée ESUS permet par ailleurs de bénéficier des réductions d’impôt sur le revenu prévues pour les investissements dans les PME non cotées avec un taux majoré de 25%, contre 18% pour le taux standard. Cela incite les investisseurs à soutenir l’ESS, en compensant en partie le rendement théoriquement plus modéré de ces entreprises en comparaison aux placements classiques.
♦ L’accompagnement à la structuration et au développement au niveau local. Le dispositif local d’accompagnement, créé en 2002, financé par l’État, la Caisse des dépôts et consignations, les collectivités territoriales et le Fonds social européen, soutient chaque année environ 6 000 structures de l’ESS, dont 95% d’associations, pour consolider leur modèle économique, mutualiser les fonctions support ou professionnaliser la gouvernance. Considérés par la Commission européenne comme des « clusters d’innovation sociale », les pôles territoriaux de coopération économique (209 projets labellisés depuis 2013) réunissent sur un même territoire des acteurs de l’ESS qui mutualisent leurs ressources pour développer des projets entre différents acteurs (entreprises, collectivités, chercheurs, organismes de formation, etc.).
⇒ L’impact de l’ESS.
♦ La contribution de l’ESS au développement de l’économie circulaire est structurante : les 3 327 structures de l’ESS référencées en 2022 pour une activité de gestion des ressources et des déchets (dont 84% sont des associations) organisent la collecte, le tri, la réparation, le réemploi ou le recyclage de biens ménagers, textiles ou matériaux de construction. Elles combinent efficacité environnementale et impact social via l’insertion professionnelle, l’accès à des biens à bas coût, et de nouveaux métiers verts.
♦ L’ESS contribue par ailleurs à diffuser des mécanismes démocratiques en entreprise par le fait d’associer les salariés à la décision sociale et à limiter les inégalités salariales. Dans les coopératives et les mutuelles, chacun dispose du même poids dans les décisions collectives quelle que soit sa contribution financière.
Par ailleurs, au-delà de l’encadrement des bénéfices, les entreprises agréées ESUS doivent définir une politique de rémunération stricte visant à limiter les écarts de salaires et respecter ces contraintes : la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux payés ne doit pas excéder un plafond annuel établi à 7 fois le Smic, et la rémunération versée au salarié le mieux payé ne doit pas excéder un plafond annuel établi à 10 fois le Smic. Enfin, grâce à leur modèle de gouvernance multipartite, certaines structures de l’ESS, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, permettent à toutes les parties prenantes d’un projet – salariés, bénéficiaires, collectivités, partenaires – de devenir à la fois gestionnaires et bénéficiaires d’une même ressource ou d’un service.
Pour en savoir davantage : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2025/10/23/l-economie-sociale-et-solidaire-une-reponse-aux-enjeux-democratiques-sociaux-et-environnementaux
Le rapport de la Cour des Comptes
♦ Jusqu’à la publication de ce rapport, les chiffres relatifs aux soutiens publics à l’ESS n’avaient jamais été agrégés. La Cour a calculé que l’Etat consacre 16Md€ en soutien à l’ESS, soit 7% du total des aides aux entreprises. et 3,6% des dépenses nettes de l’Etat en 2024 sous forme de subventions, aides aux postes, produits de tarification, etc. La totalité de ces soutiens fait l’objet de conventions fixant des objectifs en matière de contribution aux politiques publiques. Seules 4% des entreprises de l’ESS bénéficient de subventions. “Ainsi, le rapport de la Cour des Comptes tord le cou à la fable d’une économie subventionnée, l’ESS recevant moins de soutien que l’économie conventionnelle.”
♦ Quelle évolution dans le temps et pour quel type d’activité ?
Quel financement des collectivités locales et quelle évolution dans le temps?
♦ Les chiffres présentés par la Cour démontrent également, qu’à champ constant et en corrigeant l’inflation, les subventions dédiées à l’ESS augmentent moins que le budget de l’Etat, et ce malgré l’augmentation des besoins sociaux auxquels l’ESS apporte des réponses.
Le rapport note l’absence de pilotage stratégique de l’Etat des politiques publiques relatives à l’ESS, ce qui prive la France de chances pour trouver des solutions aux besoins de protection et de transitions auxquelles elle doit faire face.
De plus, la Cour encourage l’Etat et ses opérateurs, BPIFrance en particulier, à faire évoluer leur doctrine relative au financement des entreprises de l’ESS.
Pour en savoir davantage : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/77638
Les sociétés commerciales de l’ESS : l’essentiel
Créées par la loi de 2014, les sociétés commerciales de l’ESS (SCESS) forment la plus récente des 5 familles de l’ESS. En dix ans, 4 501 entreprises ont adopté cette forme hybride qui combine statut commercial, utilité sociale, gouvernance partagée et lucrativité encadrée.
Pour cela, elles doivent répondre à 3 conditions précises inscrites dans leurs statuts : rechercher une utilité sociale, adopter une gouvernance démocratique, et affecter la majorité de leurs bénéfices au développement de leur activité.
Leur reconnaissance repose sur une démarche simple : une validation des statuts par l’assemblée générale, puis un enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce, après contrôle du greffier. Ce statut donne accès à l’ensemble des droits reconnus aux entreprises de l’ESS, notamment en matière de marchés publics, d’appels à projets ou de financement.
Elles sont actuellement au nombre de 4 501 : elles étaient 1 320 avant 2021 et 2 832 entre 2021 et maintenant.
3 147 le sont en SAS dont 1 303 avec associé unique, 1 030 en Sarl dont 460 à associé unique et 83 en om collectif.
La moitié sont de fait des services : 2 176 des services aux entreprises dont en informatique 372, et 626 en autres services dont 420 en action sociale, éducation et santé, 131 en activités financières, 75 en sport et activités récréatives,
21% le fait de commerce (655) et de HCR (254), 14% (638) dans l’industrie et la construction et 61 dans l’agriculture.
Pour en savoir davantage : https://www.ess-france.org/les-societes-commerciales-de-l-ess-l-essentiel