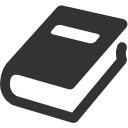Source : le Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) issu de l’exploitation de données fiscales exhaustives et de données sur les prestations sociales. La notion de ménages utilisée dans l’étude fait référence aux ménages fiscaux, ce qui permet d’identifier le foyers fiscaux ayant déclaré des dépenses de services à domicile.
L’étude s’appuie sur les données observées en 2019 et sur des projections sur la période 2019-2050 selon diverses hypothèses.
Définition : les services à la personne regroupent des activités de soutien aux individus et aux familles, réalisées au domicile des ménages qui y font appel (assistance aux personnes âgées ou dépendantes, ménage, jardinage, soutien scolaire, etc.), que ce soit de gré à gré (particulier employeur) ou par l’intermédiaire d’un organisme (prestataire).
Le nombre de personnes travaillant dans les services aux personnes dépend non seulement du type de prestation mais aussi de la localisation de la population utilisatrice et de la configuration des foyers.
⇒ Combien sont-ils, où ces ménages sont localisés, combien dépensent ils ?
♦ En 2019, 3,9 millions de ménages ont recours aux services à la personne en France métropolitaine, en Martinique et à La Réunion, soit 13,8% des ménages qui y résident.
Entre 2013 et 2019, le nombre de ménages utilisateurs de services à la personne a augmenté de 270 000, porté principalement par le vieillissement de la population.
Les ménages dont la personne de référence a 80 ans ou plus se distinguent par un taux de recours très élevé (41%), notamment pour faire face à la dépendance, principale activité des organismes prestataires ; 20% des 10% de ménages âgés les plus modestes y ont recours.
♦ Le fort recours des ménages résidant à l’Ouest de l’Hexagone contraste avec une utilisation nettement moins fréquente dans l’Est, en Corse, en Martinique et à La Réunion.
Au sein des aires d’attraction des villes, le taux de recours est plus fort dans les couronnes que dans les pôles, ce qui s’explique par des différences entre les caractéristiques des populations peuplant ces territoires.
♦ La moitié des ménages utilisateurs ont dépensé plus de 1 430€ (dépense médiane). Cependant, ces montants varient très fortement d’un ménage à l’autre : les 10% des ménages qui dépensent le plus y consacrent 5 510€, une somme 24 fois supérieure à celle des 10% des ménages qui dépensent le moins.
Parmi les utilisateurs, la dépense médiane est nettement supérieure à la médiane nationale en Martinique (2 200€) et à La Réunion (2 430€), alors que le taux de recours y est faible. De manière générale, plus le recours est répandu dans un territoire, moins l’usage est intensif.
En Île-de-France la dépense médiane est la plus élevée de l’Hexagone (2 240€), tous les départements de cette région se situant au-dessus de la médiane nationale, alors que les taux de recours y sont très hétérogènes, avec des taux parmi les plus élevés de France (Paris, Hauts-de-Seine) et d’autres parmi les plus bas (Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise).
Rappelons que l’Île-de-France connait une forte proportion de ménages aux revenus très élevés (10% y ont un niveau de vie annuel supérieur à 49 100€ en 2019, soit 10 000€ de plus que pour l’ensemble).
♦ Le recours aux services à la personne augmente ainsi avec le niveau de vie ; parmi les 10% de ménages les plus aisés, 40% y ont recours ; les ménages aisés ne se limiterait pas à satisfaire des besoins essentiels, comme pallier une perte d’autonomie, mais pourrait aussi s’inscrire dans une recherche d’un meilleur confort de vie ou d’une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle (aide pour les tâches domestiques et la garde d’enfants…)
♦ Le recours aux services à la personne dépend également de la composition des ménages et du mode de cohabitation. Lorsque la personne de référence a moins de 65 ans, les familles avec enfants font plus souvent appel aux services à la personne que les ménages sans enfants (garde de jeunes enfants à domicile, accompagnement scolaire ou aide aux tâches ménagères). Les jeunes familles monoparentales utilisent pourtant moins ces services que les couples. En revanche, le besoin est très marqué pour les personnes âgées vivant seules, en particulier celles de 80 ans ou plus, dont le taux de recours est de 44%.
La jeunesse de la population parisienne, notamment de jeunes vivant seuls, limite le recours aux services à la personne. En Martinique et à La Réunion, la présence de différentes générations au sein d’un même ménage est fréquent, ce qui diminue les besoins d’aide extérieure pour les personnes âgées.
Noter que la composition des ménages varie relativement peu d’une région de France métropolitaine à une autre.
⇒ L’évolution à 2050.
♦ D’ici 2050, le nombre de ménages utilisateurs augmenterait pour atteindre 4,4 à 5,5 millions. Dans le scénario central, environ 5 millions de ménages auraient recours aux services à la personne, soit une hausse de 27%. La hausse du nombre de personnes de 80 ans ou plus, serait le principal moteur de la hausse (85% de l’effet total), alors que l’augmentation de la population totale contribuerait à hauteur de 10%, et que l’évolution de la structure des ménages jouerait pour 5%.
♦ La hausse du recours aux services à la personne serait plus forte sur la façade atlantique et dans le Sud-Est (autour de 45%), exception les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes avec seulement 20%, la population restant en moyenne plus jeune, notamment dans les aires d’attraction des villes de Marseille et de Nice. Du centre jusqu’au Nord-Est, la population diminuerait et ne vieillirait plus beaucoup (hausse de 10 à 20%).
D’ici 2050, les 20 départements les plus peuplés, avec de grandes agglomérations, contribueraient pour 50% à la hausse du nombre de ménages utilisateurs (vieillissement des périphéries, alors que les pôles urbains resteraient jeunes).
♦ Un peu plus d’un million de salariés travaillent dans les services à la personne en 2019, la plupart à temps partiel, soit 400 000 emplois en EQPT. Si la consommation de services progressait au même rythme que le nombre de ménages utilisateurs d’ici 2050, les évolutions à venir nécessiteraient 100 000 emplois en EQPT de plus, ou 300 000 salariés de plus à temps partiel constants. Mais les besoins pouvant être plus importants, il faudrait 170 000 EQPT en plus, soit 500 000 salariés à temps partiel. En plus de salariés supplémentaires à recruter d’ici 2050, le secteur devra également faire face au renouvellement de 800 000 salariés qui y travaillent actuellement.
Pour en savoir davantage : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8383720