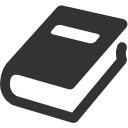Source : essentiellement les données du Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de France. Le périmètre d’étude couvre les entreprises localisées en France, soumises à l’IS, n’appartenant pas au secteur financier, et dirigées par des personnes physiques. Au total, l’échantillon étudié concerne, pour 2023, environ 1,4 million d’entreprises, qui représentent de l’ordre de 70% de la valeur ajoutée des entreprises françaises. les microentrepreneurs (au sens fiscal du terme) ne sont pas inclus dans cette étude.
Le terme de « dirigeant » est synonyme ici de mandataire social. L’identité du mandataire social d’une entreprise dépend en effet de son statut juridique : il s’agit du gérant dans une SARL, du directeur général (DG) et du directeur général délégué (DGD) dans une société anonyme ; le président d’une SAS est automatiquement mandataire social.
Les femmes géreraient leur entreprise différemment des hommes ?
⇒ L’importance des femmes chefs d’entreprise diffère selon la taille des entreprises.
♦ Les femmes sont 49% de la population active, mais seulement 25% des dirigeants d’entreprise (au sens de mandataire social). Ce chiffre tombe à 17% dans les ETI et les grandes entreprises (GE) ; il est de 26% dans les TPE et 19% dans les PME.
En pratique, une entreprise peut avoir un ou plusieurs dirigeants. Lorsque l’entreprise est dirigée par une seule personne, il s’agit d’une femme dans 22% des cas. Lorsqu’il y a plusieurs dirigeants, l’équipe de direction est intégralement féminine dans 6% des cas, intégralement masculine dans 41% des cas, et le plus souvent mixte (53%).
♦ La France se classe en tête des pays de l’OCDE en matière de féminisation des conseils d’administration et de surveillance des groupes cotés (46% en 2022, contre 43% en Italie, 35% en Allemagne, 32 % aux États-Unis, et 15 % au Japon). La France se classe par ailleurs dans le 1er tiers des pays de l’OCDE concernant la part des femmes « managers » (plus large que le Comex, et pour des entreprises cotées ou non) : 38% en 2021, contre 41% aux États-Unis, 29% en Allemagne et en Italie, et 13% au Japon.
⇒ Mais leur nombre progresse.
♦ La féminisation a augmenté au cours des 20 dernières années, en particulier au sein des ETI et des GE où elles étaient 5% au début du 21éme siècle. Le déséquilibre femmes-hommes est également marqué dans les entreprises cotées en bourse, où elles sont 18% des postes de président ou de directeur général (DG) des entreprises du SBF 120 en 2022 (contre 7% en 2017). Dans les groupes du CAC 40 (une sous-partie du SBF 120), les femmes n’occupent que 6,25% des postes de président ou de DG des entreprises du CAC 40 en 2023 (contre 3,75% en 2022 et 2,5% en 2021).
Rappelons que la loi Copé-Zimmermann de 2011 impose des quotas de femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance des plus grandes entreprises (20% à l’horizon 2014, 40% à l’horizon 2017 et en réalité 46% en 2022) ; par ailleurs, la loi Copé-Zimmermann de 2011 impose des quotas de femmes au comité exécutif (Comex) des entreprises de plus de 1 000 salariés (30% en 2026, 40% en 2029, alors qu’actuellement elles sont 29%).
⇒ Les secteurs d’activité des femmes chefs d’entreprise.
Les secteurs les moins féminisés sont la construction et le transport, avec respectivement 4 et 10% d’entreprises dirigées majoritairement par des femmes ; à l’inverse, les secteurs les plus féminisés sont l’enseignement, la santé et l’action sociale (35%) et les autres services, dont les activités récréatives (46%). Les sous-secteurs les plus féminisés ont ainsi trait à la bijouterie, aux enfants, à a coiffure, aux soins de beauté, à la parfumerie, aux vêtements et aux fleurs (entre 50 et 68%). À l’opposé, les sous-secteurs les moins féminisés concernent l’électronique, l’électricité, la plomberie, la construction et les machines (entre 3 et 4%).
La part des entreprises dirigées par des femmes est fortement corrélée à la part de l’emploi féminin dans chaque secteur ; toutefois, la proportion de femmes est toujours plus élevée dans l’ensemble de l’emploi que parmi les dirigeants (existence d’un plafond de verre ?).
♦ Noter que la part d’entreprises dirigées par des femmes n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire français, variant au niveau départemental dans une fourchette de 14 à 25%, pour une moyenne nationale de 18%. Ces écarts territoriaux doivent être interprétés avec précaution. Ils reflètent notamment les spécificités sectorielles de chaque département.
⇒ Les femmes doivent franchir plus de barrières que les hommes pour devenir dirigeantes.
♦ Les contraintes familiales continuent de peser davantage, les femmes allant davantage vers des « flexible jobs », moins payés mais qui laissent du temps pour s’occuper de leur famille. Les postes de chef d’entreprise, qui nécessitent souvent un investissement personnel majeur, se rapprochent des comportements des hommes (rémunération liée au nombre d’heures travaillées, et disponibilité importante).
Selon une enquête de Bpifrance (2022) 37% des conjoints de dirigeantes ne s’occupent pas de la gestion quotidienne du ménage, contre seulement 14% des conjointes de dirigeants.
Selon la DGE (2019), les contraintes familiales sont désignées comme le frein principal à la création d’entreprises par les femmes (40% des femmes entrepreneures sont célibataires vs 21% des hommes). Ainsi, plus la part de célibataires est importante dans un département, plus il y a d’entreprises dirigées par des femmes.
♦ D’autres facteurs sont régulièrement avancés : un accès au financement plus difficile, les recrutés ont des préférences sur le genre de leur employeur de sorte que les dirigeantes pourraient avoir à offrir de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail pour attirer des collaborateurs.
⇒ Les femmes dirigeantes sont-elles des gestionnaires plus prudentes ?
♦ Une enquête récente de Bpifrance (2022) montre que les femmes se comportent davantage comme des « gestionnaires prudentes » (36% vs 27 pour les dirigeants masculins), davantage préoccupées par leur souhait de pérenniser l’entreprise ; les femmes auraient moins confiance en elles que les hommes, et auraient davantage d’aversion pour le risque. Mais il ne faut pas oublier les différences au sein d’une même catégorie de genre.
L’analyse statistique des données FIBEN tend à confirmer l’idée d’une gestion en moyenne plus prudente pour les femmes dirigeantes, appréhendée en se focalisant sur la trésorerie ou les capitaux propres des entreprises. Quelle que soit l’année considérée, de 2019 à 2023, on constate que les entreprises dirigées par des femmes conservent un matelas de trésorerie (mesuré en termes de trésorerie/actif total) sensiblement supérieur aux entreprises dirigées par des hommes, de l’ordre de +1,5 point de pourcentage, à comparer à un moyenne de 26% sur l’ensemble de l’échantillon. Les entreprises dirigées par des femmes conservent également un coussin de capitaux propres (mesuré en termes de capitaux propres/passif total) plus important, de l’ordre de +1,5 à +2 points selon les années (pour une moyenne de 31% sur l’ensemble de l’échantillon). Cet écart s’explique en premier lieu par une propension plus faible à verser des dividendes de –1 à –2 points (pour une moyenne de 30%).
♦ Leur taux de croissance annuel de l’actif total des entreprises dirigées par des femmes est inférieur de 0,2 point (pour une croissance annuelle moyenne de 9% sur 2019-2023). Les résultats sont similaires si l’on considère la croissance du chiffre d’affaires.
L’explication de ces écarts peut refléter une gestion plus prudente, mais aussi refléter des différences en matière d’éducation financière ou d’accès au financement externe, ou encore le fait que les femmes sont davantage concernées par les sujets environnementaux, ce qui peut affecter leurs choix de gestion, à travers notamment leur politique RSE.
Ma réflexion : ces données issues des fichiers Banque de France (et ne couvrant pas la totalité du champ des entreprises, mais largement celle des sociétés) abordent finement la place des femmes dans ces sociétés ; ce qui en fait une étude rare.