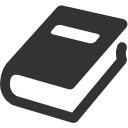La reprise de la productivité fait suite à un ralentissement de l’emploi, jugé en surnuméraire au regard des besoins de production.
La productivité du travail en France a traversé un long passage à vide entre la crise sanitaire et la fin 2022. Elle s’est ensuite redressée, progressant au rythme annuel de +1,3% depuis le début de 2023 dans le secteur marchand non-agricole, plus rapidement que sa tendance de long terme (+0,9% par an), mais elle demeure 5% en dessous de sa trajectoire tendancielle.
Entre fin 2019 et fin 2024 la croissance de l’emploi a été très forte : l’emploi salarié marchand a crû de +6,1%, alors que la valeur ajoutée ne progressait que de +5,5%.
Les dernières ruptures de tendance de productivité remontent aux années 1990 et 2000, en lien avec les politiques d’allègement de cotisations et de réduction du temps de travail qui ont enrichi la croissance en emplois.
Au sortir de la crise sanitaire : fin 2020 le niveau de productivité était de -4,1%. Après la crise sanitaire, la productivité s’est accrue, d’abord lentement de +0,5% par an en moyenne en 2021 et 2022, puis plus vivement et au-delà de sa tendance, à rythme annuel moyen de +1,3% depuis le début 2023.
D’où viennent cette baisse de la productivité ?
Le niveau de l’emploi salarié a été supérieur aux besoins pendant la crise sanitaire et juste après ; il demeurait très élevé avec 982 000 emplois salariés surnuméraires fin 2024, notamment du fait de la baisse de la durée du travail (horaires réduits, activité partielle, arrêts maladie, surcroît d’absentéisme, etc.).
Par ailleurs, la politique de soutien à l’apprentissage explique près de 30% de cette baisse, suivie par la politique de soutien aux entreprises (17%) et la baisse du coût du travail principalement liée au retard d’indexation des salaires aux prix (13%) ; la baisse du chômage et ce qu’elle emporte en termes de profil des actifs (9%) et la contraction persistante de la durée du travail (6%) jouent également un rôle significatif.
L’incorporation récente des non-salariés dans les mesures de la productivité modifie peu la hiérarchie des différentes variables identifiées dans le modèle de base.
Ces données, cumulées avec les incertitudes conjoncturelles actuelles, permettent de comprendre le ralentissement de l’emploi et sa faible poursuite estimée pour 2025.
La baisse de la productivité a été plus sensible dans les services, notamment du fait de l’apprentissage, les créations d’emplois d’apprentis représentant plus de 40% des emplois surnuméraires à la fin 2024.
Dans l’industrie, c’est davantage le fait du coût du travail, les entreprises ayant hésité à se séparer de leurs salariés qualifiés dans une période où coexistaient des difficultés d’approvisionnement et de recrutement.
Dans le secteur de la construction, ce sont les aides aux entreprises qui apparaissent comme le principal facteur explicatif du nombre inhabituel d’emplois créés.
Pour en savoir davantage : https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2025/OFCEpbrief142.pdf